
Engagé·es contre la privatisation de l’Université et les réformes de casse du service public
Pour poursuivre l’objectif de l’enseignement supérieur qu’est la recherche et la transmission du savoir, il est nécessaire de défendre un modèle de service public. Or, le démantèlement de ce service public universitaire se poursuit méthodiquement alors que les politiques de ces dernières décennies ont permis une libéralisation progressive de l’enseignement supérieur. La suppression des aides pour les étudiant·es étranger·es, l’augmentation des frais d’inscription, la mise en concurrence des établissements. Autant de mesures, qui trouvent leur origine dans le modèle universitaire des pays anglo-saxons, résonnent aujourd’hui en France. Nous assistons ainsi, de manière de plus en plus flagrante, à une privatisation croissante de l’enseignement supérieur public en France.
La mise en place du classement de Shanghai en 2003 constitue un tournant majeur dans la logique de privatisation de l’ESR français. Ce classement, comporte d’importantes limites méthodologiques, impose une vision compétitive des universités, renforçant l’idée selon laquelle les établissements doivent être mis en concurrence à l’échelle nationale et internationale. Le discours est alors à la mise en compétition des universités pour s’engager dans une logique de mercantilisation et de compétition des savoirs. La priorité n’est donc plus dans la qualité des enseignements transmis mais dans les bénéfices que l’on peut en tirer, rompant totalement avec l’idée consubstantielle à la notion d’enseignement : la recherche d’une émancipation par le savoir. L’objectif à terme est donc de réduire drastiquement le nombre de places dans toutes les filières dont la sphère économique privée ne peut retirer de bénéfices immédiats. Cette dynamique se concrétise en 2007 avec la loi d’autonomie des universités (dite loi LRU). Cette réforme marque un premier pas vers un désengagement progressif de l’État dans la gestion directe des établissements et encourage le développement de financements privés par le biais de partenariats avec des entreprises ou des fondations.
Dans la continuité de cette logique de mise en concurrence, la création des établissements publics expérimentaux (EPE) prolonge l’idée d’une privatisation progressive de l’enseignement supérieur. Les EPE regroupent plusieurs institutions (universités, grandes écoles, organismes de recherche) et se regroupent sous une nouvelle forme juridique avec une perte de contrôle de l’Etat dans leurs organisations internes et leurs gouvernances. Ce statut dérogatoire aux règles élémentaires fixées par le code de l’éducation laisse les appels à projet et la concurrence entre établissements primer sur nos conditions de vie et d’études. La réforme des EPE vise à faire émerger de grands pôles universitaires capables de mieux figurer dans les classements internationaux, elle accentue la logique de compétitivité et ouvre encore plus l’enseignement supérieur aux mécanismes de marché.
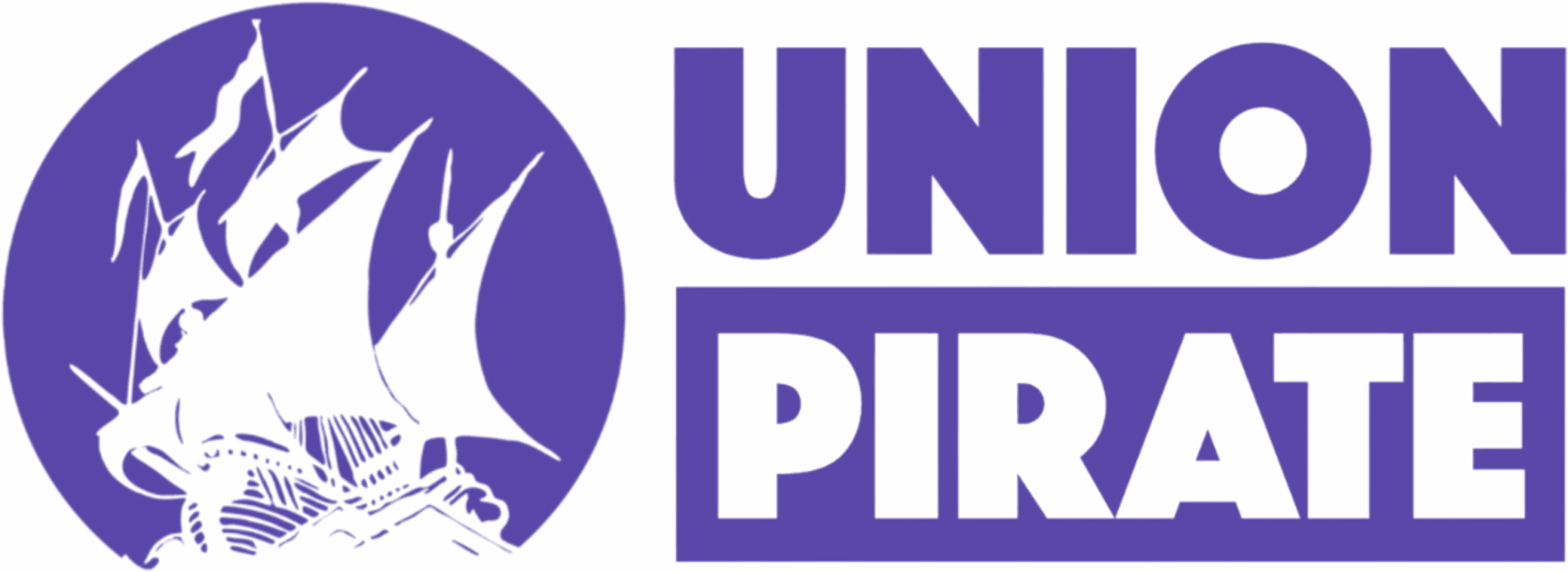

MOBILISATION contre l’établissement public expérimental
À Brest, où la Présidence de l’Université à tenté de faire voter la mise en place d’un EPE annoncé à la rentrée 2024 en moins de trois semaines, bafouant tout principe de démocratie universitaire et les droits des étudiant·es. L’Union Pirate Finistérienne a été fer de lance de la mobilisation permettant le report de cet EPE en envahissant le Conseil d’administration, en mobilisation dans des assemblées générales et des rassemblements. Face à la mobilisation de la communauté universitaire, la Présidence de l’Université à fait le choix de délocaliser le Conseil d’administration en dehors de l’établissement avec un dispositif policier imposant visant à faire passer par la force le vote.
La réforme dite « Acte 2 de l’autonomie des universités » s’inscrit dans cette logique de libéralisation de l’enseignement supérieur. Pour l’année universitaire 2024/2025, neuf universités ont été désignées comme tests. L’autonomie y est repensée selon cinq axes : ressources humaines, finances, pédagogie, gouvernance et recherche. Elle vise une généralisation à l’ensemble des universités dès l’année suivante. Face à cette soumission de l’université publique aux dogmes libéraux et aux logiques de marché, les élu·es de l’Union Étudiante lutteront coûte que coûte contre la marchandisation de la jeunesse.
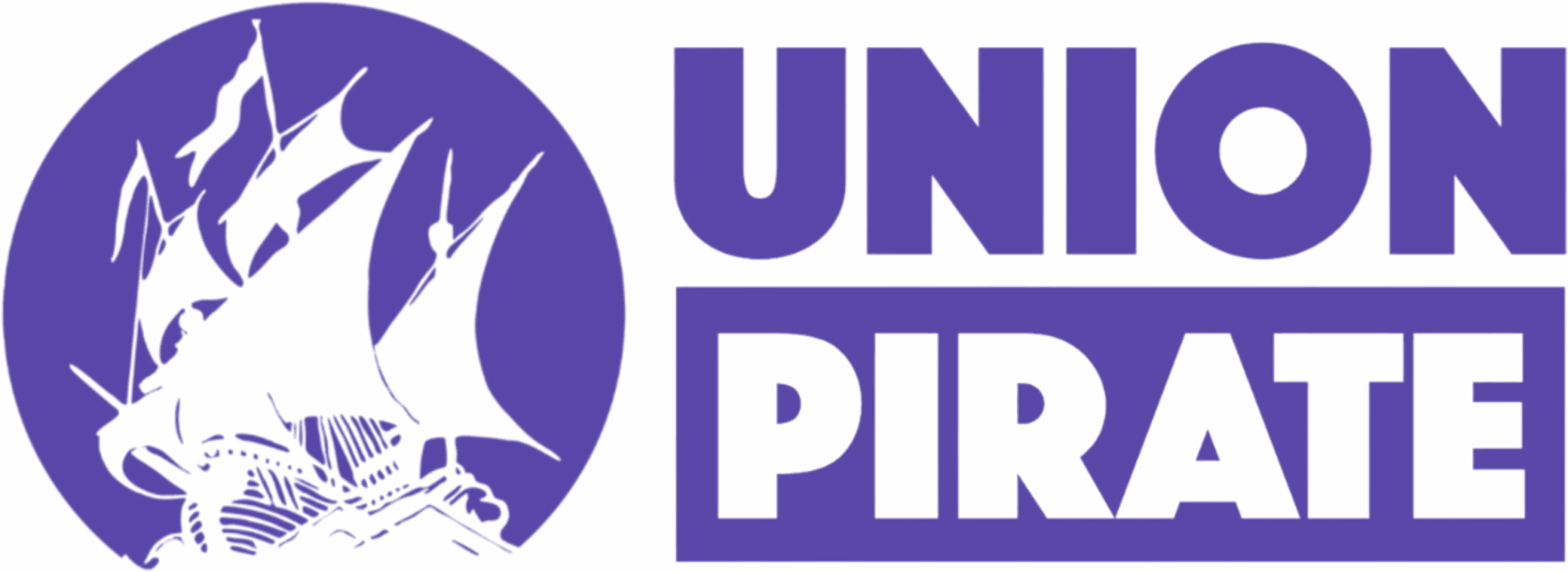
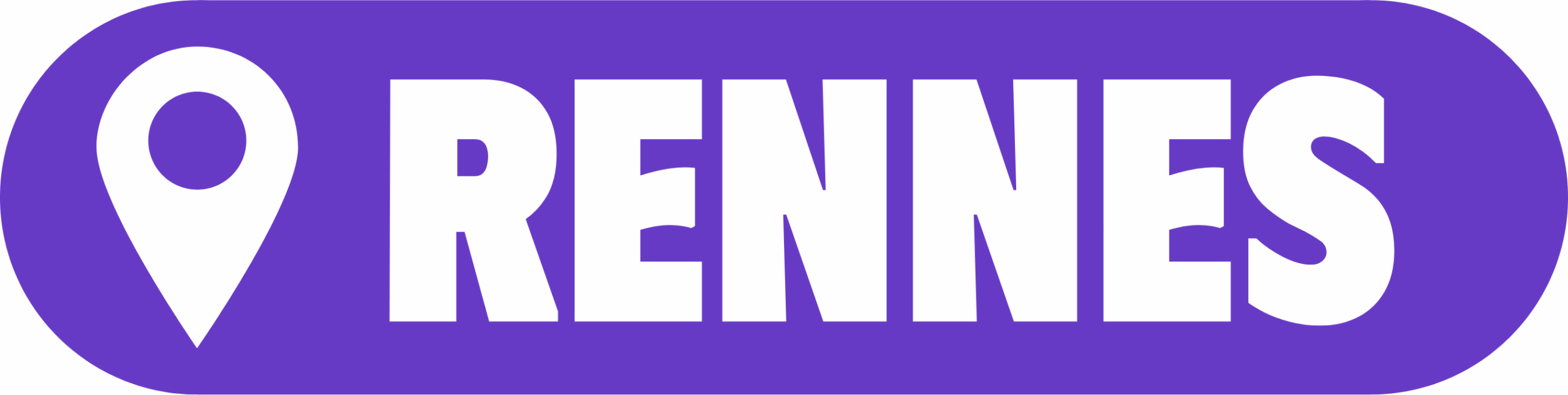
une victoire contre la fusion et Une lutte qui continue contre l’autonomie des universités
Face à ces attaques contre l’enseignement supérieur public, l’Union étudiante s’est toujours battue contre les appétits prédateurs de la sphère privée et les logiques de privatisation du service public. En 2021, les élu·es de l’Union Pirate Rennes 2 gagnent une longue bataille débutée en 2017, cette victoire permet d’empêcher une fusion entre l’université de Rennes 1 et de Rennes 2. Pourtant malgré cette victoire, l’université de Rennes 1 a pris la décision de s’engager seule sur la voie des politiques libérales de regroupement universitaire et s’est constituée en EPE sous le nom “Université de Rennes” comme un signal que la victoire gagnée de haute lutte par nos syndicats ne marque pas la fin du combat contre ce projet néfaste.
Par leur statut d’EPE, les universités de Rennes, de Bordeaux et d’Aix-Marseille ont été choisies comme lieu d’expérimentation de cette nouvelle réforme, ce qui a mené à une mobilisation de nos syndicats locaux contre son application et ses conséquences. Parmi les différentes mesures retenues par ces trois établissements figure une gestion plus autonome des ressources humaines et la formation, avec pour conséquence majeure de priver les travailleurs·euses et les usager·es des garanties qu’offre le service public sur les conditions de recrutement et de travail. Par ailleurs, dans le domaine du patrimoine, l’autonomie a un effet facilitant s’agissant du recours à des filiales privées telles que Kampus 2030 à Rennes, dont le contrôle est assuré par des organes des universités comptant peu si ce n’est aucun·e représentant·e des employé·es et étudiant·es.
Pour ce qui est de l’encadrement des formations, la promotion de l’autonomie des universités permet l’augmentation des frais d’inscription afin de compenser les sous dotation de l’État, ou encore la réduction de l’offre de formation. L’effet de ces mesures ne peut qu’être celui de réserver l’enseignement supérieur à une classe sociale aisée, ce qui est un facteur fort de reproduction sociale et va à l’encontre d’un modèle universitaire émancipateur et ouvert à tou·tes. Nos organisations locales ont entrepris d’informer les étudiant·es et de construire une mobilisation sur les campus.
Fort·es de ce rapport de force, les élu·es Union Pirate Rennes 1 ont porté une motion en conseil en juin dernier. Iels ont obtenu que les administrateurs·rices se prononcent en majorité pour le report du vote sur l’entrée de l’université de Rennes dans l’expérimentation de l’acte 2 qui, à l’heure d’aujourd’hui, n’a toujours pas été remis au vote.